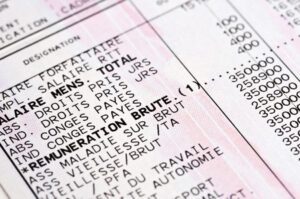Une salariée embauchée à temps partiel reproche à son employeur d’avoir modifié unilatéralement son temps de travail. Après avoir figuré sur une seule ligne de son bulletin de paie pendant 13 ans, son salaire mensuel pour 130 heures de travail faisait en effet désormais l’objet de deux lignes distinctes, l’une correspondant aux heures de travail proprement dites, l’autre au temps de pause.
Pour la débouter de sa demande en paiement de rappels de salaire, les juges considèrent toutefois que, nonobstant le changement d’affichage du salaire sur le bulletin de paie, l’intéressée est toujours rémunérée 130 heures, les heures de travail et les temps de pause étant payés au même taux horaire.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. En statuant comme ils l’ont fait, alors que la durée contractuelle de travail, base de calcul de la rémunération, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifiée sans l’accord de la salariée, peu important la rémunération conventionnelle du temps de pause au même taux horaire que le temps de travail, les juges ont en effet violé les articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil (devenu 1103) relatifs au consentement des parties contractantes et à la bonne foi contractuelle.
L’affaire devra donc être rejugée.
Cour de cassation, chambre sociale, 13 mars 2024, pourvoi n° 22-22.032