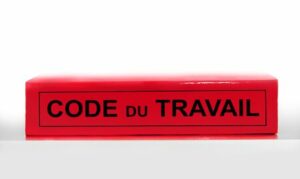La loi du 22 avril 2024 a profondément modifié les règles d’acquisition des congés payés en cas d’arrêt maladie non professionnelle. Désormais, ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif et ouvrent droit à des congés payés : deux jours ouvrables par mois d’absence, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence, correspondant au minimum à quatre semaines de congés annuels.
L’application concrète de ce plafond a toutefois suscité de nombreuses interrogations, notamment lorsque le salarié dispose de congés acquis au titre de périodes antérieures et reportés.
Par un arrêt du 21 janvier 2026, la Cour de cassation apporte une clarification essentielle sur le sujet.
Dans cette affaire, une salariée, placée en arrêt maladie non professionnelle sur plusieurs mois répartis entre deux périodes de référence distinctes, sollicitait un rappel d’indemnité de congés payés, en application des nouvelles règles issues de la loi du 22 avril 2024.
Dans un souci de limitation des droits invoqués, l’employeur soutenait que le plafond de vingt-quatre jours devait être apprécié globalement, en tenant compte des congés acquis antérieurement, des congés reportés et des congés nouvellement acquis au titre des arrêts maladie.
Saisie du litige, la Cour de cassation rejette ce raisonnement, jugeant que les congés payés acquis au titre de périodes antérieures et reportés faute d’avoir été pris ne doivent pas être intégrés dans l’appréciation du plafond de vingt-quatre jours ouvrables. Ce plafond doit s’apprécier exclusivement par période de référence, en ne tenant compte que des droits ouverts au titre de cette période, indépendamment des congés issus de périodes antérieures.
Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-22.228